Le défaut d’assurance engage-t-il la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société qui a pour activité la construction d’ouvrages ?

1 – L’article L. 241-1 du Code des assurances contraint « toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil » à souscrire une assurance pour couvrir ladite responsabilité.
En pratique l’activité de constructeur d’ouvrages est souvent exercée sous forme sociale. La qualité de constructeur appartient alors à la société, laquelle est débitrice, envers le maître de l’ouvrage, des garanties légales et, notamment, de la garantie décennale et doit, en conséquence, être impérativement couverte par une assurance. La société étant un être fictif, insusceptible d’accomplir par elle-même une quelconque démarche, il incombe à son dirigeant de contracter, au nom et pour le compte de la personne morale qu’il représente, l’assurance de responsabilité décennale dont la loi impose la souscription (C. assur., art. L. 241-1).
Si le dirigeant social manque à cette obligation, engage-t-il sa responsabilité personnelle à l’égard du maître de l’ouvrage ? La réponse est affirmative, sous réserve que certaines conditions soient réunies (I), ce qui peut emporter de lourdes conséquences financières pour l’auteur du manquement (II).
2 – Nota : l’étude se limite à la responsabilité civile encourue, mais il faut garder à l’esprit que le défaut d’assurance décennale expose également le dirigeant à des sanctions pénales, l’article L. 243-3 du Code des assurances prévoyant que « quiconque contrevient [à l’obligation d’assurance] sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement ».
I – Les conditions de la responsabilité du dirigeant
3 – L’engagement de la responsabilité civile personnelle du dirigeant qui a manqué à son obligation de souscrire une assurance RC décennale est subordonnée à deux séries de conditions (lesquelles sont cumulatives) afférentes d’une part à la faute commise (A/), d’autre part au dommage dont se prévaut le maître de l’ouvrage (B/).
A – Condition afférente à la faute
4 – Les articles 1240 et 1241 du Code civil permettent, en principe, l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur d’une faute dommageable, quelles que soient la nature et la gravité de cette dernière. Que la faute soit intentionnelle ou non, qu’elle soit lourde ou légère, a priori, importe peu. Des dérogations à ce principe ont néanmoins été apportées par la jurisprudence, notamment au profit des représentants (personnes physiques) des personnes morales. Le dirigeant de société bénéficie ainsi d’une immunité relative, en ce sens que sa responsabilité civile personnelle ne peut être engagée à l’égard des tiers lorsqu’il commet une simple faute de gestion. En effet, selon une jurisprudence bien établie, seule la commission d’une faute « détachable » ou « séparable » de ses fonctions est susceptible de contraindre le dirigeant à indemniser, sur ses deniers personnels, le tiers victime de sa faute (Cass. com., 22 janv. 1991, n° 89-11650 : RJDA 2/92, n° 152. – Cass. com., 28 avr. 1998, n° 96-10253 : Bull. civ. 1998, IV, n° 139 : « La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. ». – Cass. com., 20 oct. 1998, n° 96-15418 : Bull. civ. 1998, IV, n° 254. – Cass. com., 17 déc. 2002, n° 00-13484 : BJS 2003, p. 423, § 85, note L. Godon : cassation de la décision qui retient la responsabilité civile d’un dirigeant social « sans préciser en quoi [celui-ci] aurait commis une faute personnelle détachable de ses fonctions de gérant de la société ». – Cass. 2e civ., 7 oct. 2004, n° 02-14399 : Bull. civ. 2004, II, n° 439 ; JCP G 2005. I. 132, obs. G. Viney. – Cass. com., 27 sept. 2005, n° 04-11183 : Dr. sociétés 2005, comm. 221, J. Monnet. – Cass. 3e civ., 5 décembre 2024, n° 22-22.998 : bjda.fr 2025, n° 97, note N. Bargue ; Resp. civ. et assur., févr. 2025, comm. 39, S. Bertolaso).
5 – La faute détachable est caractérisée « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17092 : Bull. civ. 2003, IV, n° 84 ; Rev. Sociétés 2003, p. 479, note J.-F. Barbiéri ; RTD civ. 2003, p. 509, obs. P. Jourdain ; JCP G 2004, I, n° 101, spéc. n° 7, obs. G. Viney ; BJS 2003, n° 167, p. 786, note H. Le Nabasque, D. 2003, p. 2623, note B. Dondero. – Cass. com., 10 févr. 2009, n° 07-20445 : Bull. civ. 2009, IV, n° 21 ; JCP E 2009, 1602, B. Dondero).

6 – Le manquement, par le dirigeant social, à l’obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale, pour le compte de la société qui, en raison de son activité de construction, est assujettie à pareille obligation, est nécessairement constitutif, selon la Cour de cassation, d’une faute « séparable des fonctions » (Cass. crim., 30 mars 1989 : RGAT 1989, p. 603. – Cass. crim., 7 sept. 2004, n° 03-86292 : RGDA 2005, p. 162, note J.-P. Karila. – Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-66172. – Cass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66255 : Bull. civ. 2010, IV, n° 146 ; Resp. civ. et assur. 2010, comm. 327, H. Groutel. – Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26298 : RD imm. 2015, p. 85, note P. Dessuet. – Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15326 : RGDA mai 2016, p. 255, note M. Asselain. – Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 22-22.998 : bjda.fr2025, n° 97, note N. Bargue ; Resp. civ. et assur., févr. 2025, comm. 39, S. Bertolaso).
La solution s’explique sans doute par le fait que le défaut de souscription d’une assurance de responsabilité décennale est, aux termes de l’article L. 243-3 du Code des assurances, constitutif d’une infraction pénale. Or la commission d’infractions pénales ne relève évidemment pas de « l’exercice normal des fonctions sociales » (en ce sens, Cass. com., 9 déc. 2014, n° 13-26298 : RD imm. 2015, p. 85, note P. Dessuet : « le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice »). Il demeure que la solution est sévère pour le dirigeant, auteur du manquement, dans la mesure où l’omission de contracter une assurance peut être le résultat d’une simple négligence ou d’une erreur de bonne foi, dans lesquelles il est difficile de voir « une faute d’une particulière gravité », caractéristique de la faute « détachable » (V., en particulier, les faits ayant donné lieu à Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 22-22.998 : bjda.fr 2025, n° 97, note N. Bargue ; Resp. civ. et assur., févr. 2025, comm. 39, S. Bertolaso : en l’espèce, la qualification de l’activité de la société – simple maîtrise d’ouvrage déléguée non soumise à l’obligation d’assurance ou mission assimilable à celle d’un constructeur exigeant la souscription d’une assurance – était incertaine. Dans ce contexte, le gérant de la société pouvait s’être abstenu en toute bonne foi de souscrire une assurance couvrant une responsabilité à laquelle il pensait que sa société ne serait pas exposée. La faute « détachable » est néanmoins retenue par l’arrêt).
7 – Quoi qu’il en soit, en l’état actuel de la jurisprudence, l’omission de souscrire l’assurance obligatoire est systématiquement constitutive d’une faute séparable des fonctions sociales et, en conséquence, susceptible d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant, sous réserve que les conditions afférentes au dommage soient également réunies.
B – Conditions afférentes au dommage
8 – L’engagement de la responsabilité civile – dont l’objet est de permettre à la victime d’obtenir une indemnisation – est subordonné au constat de l’existence d’un dommage, lequel doit résulter directement de la faute du défendeur au procès (C. civ., art. 1240 et 1241), du fait de sa chose ou du fait d’un tiers dont il répond (C. civ., art. 1242).
9 – En conséquence, la responsabilité personnelle du mandataire social ne peut être engagée que si le maître de l’ouvrage peut se prévaloir d’un préjudice en lien de cause à effet avec la faute détachable que ledit mandataire a commise en s’abstenant de souscrire l’assurance obligatoire.
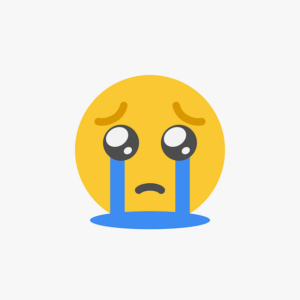
10 – En présence de désordres de nature décennale affectant l’ouvrage, le maître de l’ouvrage pourra sans difficulté établir l’existence d’un dommage direct consistant en la perte d’une chance. En effet, dans ce cas de figure, il peut faire valoir que la faute d’abstention du dirigeant lui a fait perdre une chance d’obtenir, auprès d’un assureur, l’indemnisation de ses dommages, voire, lui a fait perdre une chance d’éviter les désordres constatés en arguant qu’il se serait adressé à un autre constructeur s’il avait su que la société avec laquelle il a contracté n’était pas assurée.
11 – Si les désordres constatés ne sont pas de nature décennale, en revanche, le maître de l’ouvrage ne peut soutenir que la faute du mandataire social est à l’origine du préjudice qu’il subit. Si une assurance de responsabilité décennale avait été souscrite, l’assureur n’aurait de toutes façons pas couvert ce type de désordres, car ceux-ci ne relèvent pas du champ de la garantie obligatoire. La faute du dirigeant est certes constituée, mais elle est sans lien de cause à effet avec le défaut d’indemnisation dont pâtit le maître de l’ouvrage, de sorte que la responsabilité du dirigeant doit être écartée. Un arrêt du 5 décembre 2024, rendu par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, en offre une illustration. En l’espèce, après avoir relevé la faute détachable du dirigeant pour manquement à l’obligation d’assurance, la cour d’appel avait condamné celui-ci à indemniser le maître de l’ouvrage des désordres intermédiaires (non-décennaux) et des pertes de loyers qu’il avait subis. La cassation intervient, la Haute Cour estimant que la cour d’appel ne pouvait retenir la responsabilité du dirigeant «alors que [sa] faute personnelle […], tirée de l’absence de souscription d’une assurance décennale obligatoire, était sans lien de causalité avec le préjudice résultant des malfaçons et inachèvements dont [la cour d’appel] avait retenu qu’ils engageaient la responsabilité contractuelle de droit commun des locateurs d’ouvrage » et « alors que, l’assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvrant pas les dommages immatériels, la faute personnelle retenue à la charge [du dirigeant], tirée de l’absence de souscription d’une telle assurance, était sans lien de causalité avec le préjudice résultant des pertes locatives subies par le maître de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 5 déc. 2024, n° 22-22.998 : bjda.fr 2025, n° 97, note N. Bargue ; Resp. civ. et assur., févr. 2025, comm. 39, S. Bertolaso).
12 – En l’absence de désordres constatés au jour où le maître de l’ouvrage entend engager la responsabilité personnelle du dirigeant fautif, on aurait pu estimer que l’apparition d’un désordre décennal à l’avenir n’était qu’éventuelle et, partant, que la perte d’une chance (par la faute du dirigeant) d’en obtenir l’indemnisation par un assureur était trop incertaine pour ouvrir droit à réparation au profit du maître de l’ouvrage (la condition afférente à l’existence d’un dommage certain, qu’il soit actuel ou futur, n’étant pas remplie. V. en ce sens : H. Groutel, note sous Cass. 3e civ., 23 nov. 2005, n° 04-16.023 : Resp. civ. et assur. févr. 2006, comm. 70 et M. Périer, note sous Cass. 3e civ., 23 nov. 2005, n° 04-16.023 : RGDA janv. 2006, p. 140). La Cour de cassation ne dit pas le contraire, mais elle estime qu’une action en responsabilité est néanmoins recevable, même en l’absence de désordres décennaux, au motif que « l’absence de souscription d’une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l’entrepreneur [est] constitutive d’un préjudice certain pour le maître de l’ouvrage, qui se trouv[e] privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres» (Cass. 3e civ., 23 nov. 2005, n° 04-16.023 : Bull. civ. 2005, III, n° 225 ; Resp. civ. et assur. févr. 2006, comm. 70, H. Groutel ; RGDA janv. 2006, p. 140, note M. Périer. Dans le même sens : Cass. 3e civ., 11 mai 2023, n° 22-14.749 : Resp. civ. et assur. juill.-août 2023, comm. 192, V. Tournaire ; RGDA mars 2024, p. 39, note J.-P. Karila).
Il résulte de cette jurisprudence que le défaut de souscription est en quelque sorte présumé causer, au minimum, un préjudice (moral, immatériel ?) consistant à être privé du sentiment de sécurité que procure l’existence d’une assurance dans l’éventualité de la survenance d’un sinistre, étant précisé que les juges du fond sont souverains pour évaluer ce préjudice (mêmes arrêts).
13 – Au vu de cette jurisprudence, il semble que la responsabilité personnelle du mandataire social puisse toujours être engagée en cas de manquement à son obligation de contracter une assurance de responsabilité décennale pour le compte de sa société, car sa faute « détachable » est toujours constituée dans cette hypothèse et le dommage causé par ladite faute n’est jamais inexistant, quand bien même serait-il limité à la « privation de la sécurité » que procure l’existence d’une assurance.
Le dirigeant doit-il s’en inquiéter ? Une réponse affirmative s’impose au regard des conséquences qui s’attachent à cette responsabilité.
II – Les conséquences de la responsabilité du dirigeant
14 – L’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant contraint celui-ci à prendre en charge le montant des réparations dues au maître d’ouvrage victime (A/), à moins qu’il puisse reporter cette charge sur son propre assureur de responsabilité (B/).
A – Obligation d’indemnisation de la victime
15 – Le défaut de souscription de l’assurance obligatoire engageant la responsabilité civile personnelle du dirigeant, ce dernier peut être condamné à indemniser, sur ses deniers personnels, le préjudice causé au maître de l’ouvrage du fait de son manquement.
16 – Lorsque des désordres de nature décennale sont constatés, le maître de l’ouvrage peut se prévaloir de la perte d’une chance de toucher une indemnité de la part d’un assureur (Cf supra n°10). Certes, la réparation de la perte d’une chance ne peut être équivalente à la valeur du résultat espéré, c’est-à-dire une indemnisation complète par un assureur, car ce qui a été perdu n’est pas le résultat lui-même, mais une chance de l’obtenir (V. par ex., Cass. com. 19 oct. 1999, n° 97-13.446 : Bull. civ. 1999, IV, n°176 ; Defrénois 2000. 1278, note Lecourt : la réparation du dommage « doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée»). Cela étant, la perte d’une chance est indemnisée par le juge en tenant compte des probabilités de réalisation de la chance perdue par la faute du responsable. Or les probabilités qu’une indemnité aurait été versée si le dirigeant n’avait pas manqué à son obligation sont extrêmement élevées, dès lors que les désordres entrent bien dans la catégorie de ceux qui sont couverts par l’assurance obligatoire et que l’on peut considérer comme négligeable le risque que l’assureur (s’il avait existé) n’aurait pas été en mesure d’honorer son engagement de garantie. Autrement dit, le dirigeant qui a omis de contracter l’assurance obligatoire risque fort d’être condamné au paiement de dommages et intérêts d’un montant quasi équivalent au montant des dépenses nécessaires à la reprise des désordres.
17 – Lorsqu’aucun désordre décennal n’est constaté au jour où le juge statue, le maître de l’ouvrage ne peut réclamer réparation que du « préjudice certain [d’être] privé, dès l’ouverture du chantier, de la sécurité procurée par l’assurance en prévision des sinistres», dont on sait que l’évaluation relève des juges du fond (Cf supra n°12). Il est naturellement impossible de prédire le montant des condamnations encourues par le dirigeant au titre de la réparation de ce préjudice, ce montant dépendant des circonstances de l’espèce (et peut-être de l’humeur du juge…). A titre d’illustration, la Cour d’appel de Colmar a estimé, en présence de travaux de pose de fenêtres, que le dommage subi par le maître de l’ouvrage du fait de l’absence de couverture décennale du constructeur pouvait être évalué à 20 % du montant des travaux réalisés (CA Colmar, 8 sept. 2014, nos 14/0626 et 13/02938). Quant à la Cour d’appel de Poitiers, elle a jugé que, « au vu des éléments qui lui [étaient] soumis, notamment de l’importance des travaux réalisés, le préjudice causé [au maître de l’ouvrage] ser[ait] intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 € », dans une espèce où le demandeur réclamait 15 000 euros de dommages et intérêts (CA Poitiers, 26 févr. 2009, n° 07/000089).
18 – Les dommages et intérêts au paiement desquels le dirigeant est susceptible d’être condamné peuvent s’avérer très élevés. Il n’est pas sûr cependant qu’il doive nécessairement en supporter la charge définitive, s’il bénéficie d’une assurance couvrant sa propre responsabilité.

B – Le report de la charge de l’indemnisation sur l’assureur de responsabilité du mandataire social
19 – La plupart des dirigeants bénéficiant d’une assurance garantissant la responsabilité civile qu’ils encourent dans l’exercice de leur mandat social, est-il possible de reporter sur l’assureur la charge de leur condamnation au paiement de dommages-intérêts ? Le fait que le manquement à l’obligation d’assurance décennale soit constitutif d’un délit pénal fait-il obstacle à la couverture, par l’assureur, de la responsabilité civile résultant de la commission de ce délit ? La réponse à cette question doit être nuancée.
20 – Il faut souligner, avant tout, que le fait que le manquement à l’obligation d’assurance soit sanctionné pénalement ne suffit pas à écarter la garantie de l’assureur de responsabilité du dirigeant. En effet, s’il est admis que l’assureur ne couvre pas les fautes intentionnelle et dolosive commises par son assuré, conformément à l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances (lequel interdit la garantie de telles fautes), il est non moins admis que la commission d’une infraction pénale n’est pas nécessairement constitutive d’une faute intentionnelle ou dolosive au sens du droit des assurances (Cass. 1re civ., 22 juill. 1985, n° 84-10.087 : Bull. civ. 1985, I, n°232 ; D. 1987, somm. p. 37, obs. H. Groutel. – Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n°s 01-10.478 et 01-10.747 : Bull. civ. 2003, I, n°125 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm. 282, H. Groutel ; RGDA 2003, p. 463, note J. Kullmann. – Cass. 1re civ., 6 avr. 2004, n° 01-03.494 : Bull. civ. 2004, I, n°108. – Cass. 2e civ., 8 mars 2018, n°17-15143. – Cass. 2e civ., 16 janv. 2020, n° 18-18 909 : Resp. civ. et assur. avr. 2020, comm. 95, H. Groutel).
Les fautes intentionnelle et dolosive du droit des assurances sont en effet très strictement définies par la Cour de cassation. La première n’est caractérisée que lorsqu’il est relevé chez son auteur « une volonté de créer le dommage tel qu’il est intervenu » (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n° 03-14.389 : Bull. civ. 2004, II, n°410 ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 389, H. Groutel ; D. 2005, somm. p. 1324, obs. H. Groutel. – Cass. 3e civ., 9 nov. 2005, n° 04-11.856 : Bull. civ.2005, III, n°214 ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 370 (3e esp.), H. Groutel ; RGDA 2006, p. 632 (1re esp.), note J. Kullmann) ; la seconde, la faute dolosive, s’entend, quant à elle, « d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 25 oct. 2018, n° 16-23.103. – Cass. 3e civ., 30 mars 2023, n° 21-21084 : RGDA mai 2023, p. 21, note L. Mayaux ; RGDA juin 2023, p. 11, note J.-P. Karila ; Resp. civ. et assur. mai 2023, com. 135, S. Bertolaso. – Cass. 2e civ., 6 juill. 2023, n° 21-24.833).
Une faute, bien que pénalement réprimée, peut fort bien ne correspondre à aucune des fautes légalement exclusives de garantie au sens du droit des assurances (V., par ex., Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n°s 01-10.478 et 01-10.747 : Bull. civ. 2003, I, n°125 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm. 282, H. Groutel ; RGDA 2003, p. 463, note J. Kullmann. L’arrêt énonce que « la faute intentionnelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances, qui implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, n’exclut de la garantie due par l’assureur à l’assuré, condamné pénalement, que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction », avant d’approuver les juges du fond qui avaient estimé que les assureurs de responsabilité de deux individus reconnus coupables d’incendie volontaire par la juridiction pénale devaient garantir les conséquences de la responsabilité civile de leurs assurés).
21 – Dans ce contexte jurisprudentiel, dès lors que le défaut d’assurance décennale obligatoire, fût-il toujours un délit, ne résulte pas d’une intention de nuire au maître de l’ouvrage – ce qui caractériserait une faute intentionnelle – ou d’une abstention délibérée au mépris conscient des intérêts du maître de l’ouvrage – ce qui serait constitutif d’une faute dolosive –, l’assureur du mandataire social sera tenu de prendre en charge les conséquences financières de l’engagement de la responsabilité de son assuré à l’égard du maître de l’ouvrage privé du bénéfice de l’assurance décennale.
Maud Asselain
